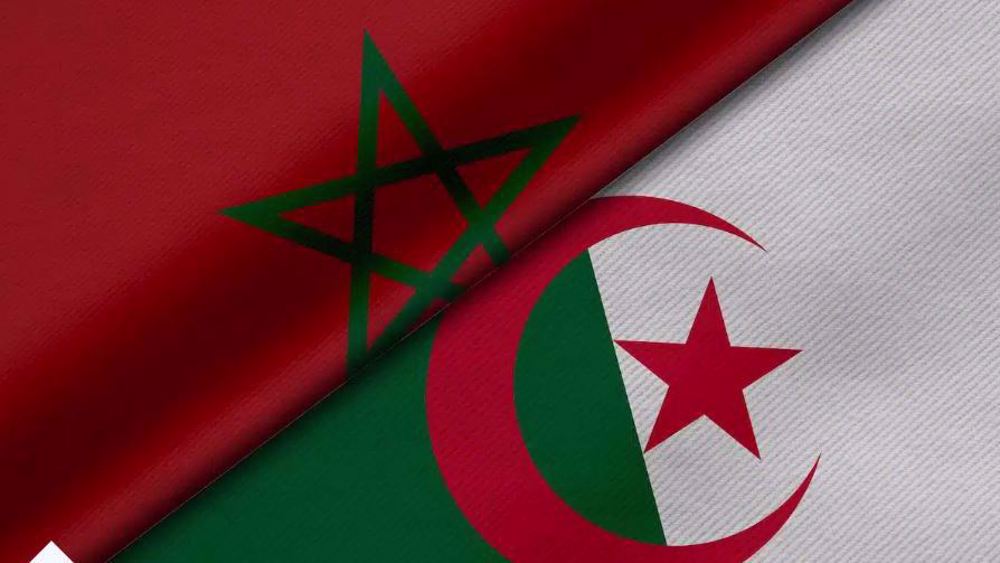Regardez et téléchargez cette vidéo sur Urmedium.com !
L’actualité en Afrique :
Les analyses de la rédaction :
1. Stop à l’attitude du blanc colonialiste !
Décidément, il est temps que l’attitude colonialiste cesse ! La France va de bourde en bourde en Afrique.
Outre les « bavures » de Barkhane, ou alors les « bourdes » culturelles qui apparaissent dans les discours néocolonialistes des dirigeants français concernant l’Afrique, les multinationales qui exploitent inhumainement les populations africaines, l’énumération serait assez longue, mais peu importe le domaine les comportements restent les mêmes. Seul hic, c’est que l’Afrique ne laisse rien passer.
Dans le monde d’aujourd’hui, l’économie et le profit priment tout, mais le fait d’avoir un comportement de « chef blanc » en Afrique doit cesser, et les chefs d’État priment cela.
Les autorités équato-guinéennes ont décidé de suspendre les vols de la compagnie Air France à destination de ce pays pour non-respect des normes de prévention adoptées contre la propagation du Covid-19.
Cette décision avec « effet immédiat » a été prise le 7 janvier 2021, après une rencontre avec les représentants de la compagnie française qui « étaient réticents à se conformer et à respecter les normes établies par les autorités de Malabo », a indiqué le gouvernement.
Pour l’instant, aucune information n’a filtré quant à la reprise de l’exploitation du ciel équato-guinéen par Air France, même si selon toute vraisemblance, la reprise des vols est assujettie au « respect intégral » des normes édictées.
« Nous ne pouvons pas sacrifier la vie de nos populations pour des raisons économiques. Chaque compagnie aérienne qui dessert notre pays est tenue de se conformer aux dispositions sanitaires en vigueur. Toute démarche contraire à ces mesures est vouée à l’échec et ceci est non négociable », indique-t-on au ministère de l’Aviation civile.
Ce genre de comportement de la part d’Air France est visible dans plusieurs secteurs, économique, militaire, social, culturel… et il serait grand temps que cela cesse.
Le « blanc » ne peut pas se sentir au-dessus des lois et devrait prendre au sérieux les règles et les lois dans les pays africains !
Plusieurs pays africains remettent les points sur les i concernant les politiques des multinationales en Afrique.
D’un autre côté, c’est bien ce même comportement néocolonial qui a poussé les pays d’Afrique à s’unir et aussi à opter pour d’autres partenariats en dehors de l’Occident.
Par exemple, le président camerounais qui a longtemps été obligé de faire des passages à l’Élysée a changé la donne en se tournant plus vers la Guinée équatoriale, qui est fervent combattant du néocolonialisme.
Porteur d’un pli fermé du président de la République, le ministre d’État, SGPR, Ferdinand Ngoh Ngoh, a été reçu jeudi dernier à Malabo par le président équato-guinéen.
« Je suis venu en qualité d’envoyé spécial du président Paul Biya auprès de son homologue et frère, le président Obiang Nguema qui m’a fort bien reçu ». Ainsi s’exprimait jeudi dernier le ministre d’État, secrétaire général de la présidence de la République au palais présidentiel de Malabo en Guinée équatoriale. Porteur d’un pli fermé du président de la République, Paul Biya à son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Ferdinand Ngoh Ngoh venait d’être reçu en audience par son hôte du jour. S’il n’a pas révélé la teneur du message dont il était porteur, l’émissaire du chef de l’État a néanmoins indiqué à la presse présente à l’issue de cet entretien qu’il s’agissait « d’un message qui a trait au renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre le Cameroun et la Guinée équatoriale ».
Ces pays, comme le Cameroun, la Centrafrique et bien d’autres, ont montré, tout comme la Guinée équatoriale, leur détachement par rapport à la France. Ils penchent en effet de plus en plus en faveur d’une coopération africaine plutôt que de ramener l’Occident à la table des négociations pour se faire imposer des diktats au détriment des populations africaines et servir les intérêts occidentaux. Ces pays montrent de plus en plus que le détachement de l’Occident est beaucoup plus bénéfique que tout le monde le pense.
La Guinée équatoriale est plus que jamais décidée à relancer son industrie pétrolière et gazière. Le premier signal positif provient des dernières prévisions en matière d’investissement issues de l’évaluation des programmes de travail et budget 2021 des opérateurs en amont. Le pays vise à devenir un hub gazier.
Le Ghana, qui s’est retiré de l’emprise du FMI a vu son économie devenir florissante. La Centrafrique et le Cameroun ont tous deux vu la sécurité s’installer dans leur pays. Le fait de demander de l’aide à l’Occident relèverait aujourd’hui de la folie, alors que beaucoup d’autres puissances sont bien là pour offrir un partenariat de type gagnant-gagnant avec l’Afrique. L’Éthiopie qui lance le barrage de la Renaissance et qui vise, avec Djibouti, de devenir des plaques tournantes économiques dans le monde.
Le potentiel est bel et bien présent, et Malabo, et d’autres pays d’Afrique commencent à voir les fruits du panafricanisme.
2. FCFA : une arnaque qui montre de nouvelles facettes tous les jours !
L’Afrique francophone aura ressenti un séisme dont l’épicentre fut situé à Dakar ou les autorités politiques et monétaires de la zone franc concédaient une dévaluation du FCFA sous les pressions de la France et du FMI.
Destinée à assainir l’économie et à relancer la croissance dans les pays de la zone, cette décision a été rendue nécessaire par l’absence de politique d’ajustement interne pour faire face aux crises d’endettement ; de déficit budgétaire chronique ; de perte de compétitivité pour l’industrie locale et de détérioration structurelle des comptes extérieurs dans les trois zones monétaires qui composent la zone franc.
Pour rappel, notons que le FCFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France a ratifié les accords de Bretton Woods et procédé à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire internationale (FMI) par le décret n° 45-0136 du 25 décembre 1945. La naissance du FCFA et la fixation de la valeur de certaines monnaies des territoires d’outre-mer libellées en francs sont ainsi actées par le General de Gaulle lui-même. La fixité du taux permet surtout aux entreprises françaises d’acquérir des matières premières et d’offrir un débouché à leurs produits manufacturés sans risque de change dans le périmètre colonial. Peut-être c’est ça le péché originel qui continue à alimenter les débats et nourrir certaines fausses intentions.
Le franc CFA signifie alors « franc des Colonies françaises d’Afrique ». Il prendra par la suite la dénomination de « franc de la Communauté financière africaine » pour les États membres de l’Union Monétaire ouest-africaine (UMOA) créée en 1962, et « franc de la Coopération financière en Afrique centrale » pour les pays membres de l’Union Monétaire de l’Afrique centrale (UMAC).
Dans les années 1970, des accords de coopération monétaire signés avec les unions monétaires se substituent aux accords bilatéraux. Ces accords visent à accroître le rôle des pays africains dans les instances de la zone franc, notamment à travers le transfert des banques centrales en Afrique : la BEAC de Paris à Yaoundé (Cameroun) en 1977 et la BCEAO de Paris à Dakar (Sénégal) en 1978.
L’arrimage et la mise sous tutelle du FCFA ont des avantages évidents pour les anciennes colonies, car la stabilité est assurée et la garantie de convertibilité vis-à-vis de l’or et de toute devise étrangère rassure les partenaires extérieurs.
Pour les masses cette situation se traduit par une inflation sinon faible du moins maîtrisée ce qui est un facteur de préservation du pouvoir d’achat et de protection de l’épargne qui, in fine, contribue au maintien de la paix sociale et de la stabilité politique.
Cependant, une suite d’évènements économiques défavorables au cours des années 1980, notamment la conjonction de la baisse du dollar et du prix des matières premières, conduit à une forte chute des recettes d’exportations et des capacités budgétaires des États de la zone franc. Cette dégradation prolongée sur une décennie a rendu nécessaire une dévaluation de 50 % des francs CFA XOF et XAF le 11 janvier 1994, la seule à ce jour. La France et le FMI tordent le bras aux autorités de la zone franc et imposent la division par deux du pouvoir d’achat et de l’épargne des ménages, accélérant la paupérisation d’une frange importante des populations aux revenus souvent faibles. La dévaluation jugée brutale par certains est encore considérée comme un traumatisme.
L’actuel président ivoirien Mr Alassane Ouattara joua un rôle crucial dans le processus en tant qu’ancien gouverneur de la Banque centrale ; chef de gouvernement de Côte d’Ivoire jusqu’en 1993 et homme de confiance de paris. Ce n’est pas par hasard qu’en décembre 2019 le président français Emmanuel Macron annonce à Abidjan, toujours devant le Président Alassane Ouattara, la mort du FCFA et son remplacement par l’Éco. La France se retire de la gestion du compte d’opérations qui centralise les avoirs extérieurs de la zone franc et ne siège plus dans les instances de décision des banques centrales de l’espace zone franc.
25 ans depuis cette dévaluation, les pays de la zone continuent dans les mêmes schémas auxquels la division internationale du travail les a confinés, à savoir la production et l’exportation de produits primaires pour l’industrie des pays du nord et de l’Asie. Les termes de l’échange continuent plus que jamais d’être plus favorables aux pays occidentaux qui rémunèrent faiblement et souvent marginalement les matières premières en Afrique ; c’est le cas par exemple du coton, du café et du cacao.
La baisse de la parité du FCFA vis-à-vis surtout des monnaies des pays industrialisés ne s’est pas traduite par une percée des biens et services produits dans les pays d’Afrique. Au surplus avec l’essor des productions de masse de la chine le tissu industriel dans la zone franc est en voie de disparition.
Les comptes extérieurs connaissent les mêmes structures déficitaires avec les importations de biens finaux et intermédiaires plus rémunérateurs. Et les bénéfices des entreprises étrangères sont automatiquement transférés vers leurs pays d’origine ; les investissements directs étrangers sont confinés aux mines ; pétrole et gaz.
Enfin, avec la pandémie de la COVID les performances engrangées dans la maîtrise des déficits budgétaires avec notamment les critères de convergence dans la zone UEMOA par exemple sont remises en question.
En définitive, il appartiendrait aux pays de la zone franc de conserver l’arrimage à l’euro ou de décider d’indexer la future monnaie à un panier de monnaies – euro, dollar, livre sterling, - correspondant à leurs principaux partenaires commerciaux. Dans tous les cas, un changement radical de modèle économique reste essentiel au vu des performances de nos économies après que la dévaluation soit intervenue il y a 26 ans jour pour jour.
3. Mali : un sondage sur Barkhane en France ; et les Maliens ?
Au Mali, outre les bavures, la perte de soldat, et surtout une situation qui a largement empiré au Sahel contrairement à ce qui était prévu à la base, les médias mainstream tentent maintenant de mettre en place un maximum d’arguments afin de disculper Barkhane.
Ce qui devient intéressant aussi, c’est que la force d’occupation Barkhane, totalement aux abois, et en quête d’un prétexte s’intéresse désormais à l’opinion française pour décider du maintien ou non de leur présence au Mali !
Selon un sondage Ifop pour Le Point, 51 % des Français se disent opposés à l’intervention française au Mali. Une première, huit ans après le déclenchement de l’opération contre des groupes terroristes.
Selon ce sondage, la moitié des Français désapprouvent l’intervention française au Mali. Ce qui montre donc qu’une bonne moitié des Français ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe réellement au Mali. D’ailleurs, pourquoi il n’y pas de sondage auprès des populations du Sahel concernant la présence ou non de Barkhane, c’est bien eux qui sont les plus concernés, non ?
Quoi qu’il en soit, la France ne projette pas de retirer entièrement ses troupes du Mali, elle prévoit une simple réduction des effectifs. En d’autres termes, Paris s’inspire de la technique américaine, qui consiste à annoncer d’abord un retrait des troupes militaires, et à l’approche de la date fatidique, d’annoncer une diminution des effectifs et un redéploiement des troupes dans d’autres pays. La France serait en train de faire pareil. Mais pourquoi occuper tant les esprits des Français avec un évènement qui ne les concerne pas ? Car ce qu’on a vu jusqu’à présent, c’est qu’aucun officiel français n’a jusqu’à présent transmis ses condoléances aux familles des milliers de Maliens qui ont été tués ces 8 dernières années, aussi bien dans le rang des civils que dans celui des FAMA. D’ailleurs, il serait intéressant de poser la question aux Français pour savoir s’ils sont au courant du nombre de morts du côté malien.
Du côté de Barkhane, le nombre de morts s’élève à près de 55. Ce qui ne ressemble pas vraiment à un nombre de morts dans une guerre.
Dans une guerre réelle, les bilans sont beaucoup plus lourds que cela. Ce qui prouve que Barkhane n’a jamais été engagé dans une « guerre » et encore moins dans une lutte contre le terrorisme, vu que le nombre de terroriste et même de groupe terroriste s’est plutôt accru. Prenons l’exemple de la Syrie, lorsque l’Iran et la Russie se sont associés à l’armée nationale syrienne et, avec l’aide de la population, ont créé un axe de la Résistance. Ils ont commencé à lutter contre les groupes terroristes de Daech, et leur nombre a considérablement diminué et Damas a été libérée de l’emprise des terroristes. D’ailleurs, beaucoup de médias affirment maintenant que Daech a quitté la Syrie et le Moyen-Orient pour se redéployer en Afrique. Mais aucun de ses médias mainstream n’ont informé les gens sur la raison de ce redéploiement. Ce qui a permis de comprendre que les États occidentaux n’ont jamais cherché à combattre le terrorisme dans le monde, car leur existence est plutôt bénéfique pour eux. Depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis ont été les premiers à instaurer l’idée du terrorisme comme prétexte pour commencer ses fameuses guerres dans plusieurs parties stratégiques du monde. L’Europe a donc emboîté le pas à cette pratique.
En 2013, lorsque la France est entrée militairement dans le pays, après y avoir été chassée par Modibo Keita lors de l’indépendance du Mali. Après ce retour de la France en 2013, les troupes d’occupation militaires n’ont plus quitté le pays. Ainsi commencent les réels problèmes du Mali. Outre l’insécurité, les problèmes économiques, sociaux, militaires… en bref, une véritable hécatombe s’est mise en place non seulement au Mali même, mais dans tout le Sahel et aussi en Afrique Subsaharienne. Le néocolonialisme bat son plein sous la bannière de la lutte antiterroriste. Le cercle vicieux du chantage en tout genre commence à s’accroître et continue de maintenir les pays africains dans un état de dépendance sécuritaire et économique. Ce qui fait que les pays africains en question n’arrivent pas à se développer. Et ce n’est pas les capacités et les moyens qui sont remis en cause. C’est bien le néocolonialisme qui fait office de bâton dans les roues du développement.
Selon les médias mainstream, les groupes terroristes seraient également intéressés par les ressources naturelles des pays dans lesquels ils s’implantent. La question, qui a d’ailleurs été posée à de multiples occasions, c’est : pourquoi les terroristes n’attaquent jamais les multinationales et leurs installations, ou encore les bases militaires occidentales en Afrique ? Lorsque les 200 terroristes ont été libérés moyennant des millions d’euros de rançon, contre 4 otages, et que les médias mainstream parlaient d’une forte insécurité qui s’était installée au Mali, les multinationales canadiennes et australiennes faisaient la queue pour s’accaparer de nouveaux contrats miniers dans le pays, comme si elles vivaient dans un « Mali parallèle ».
En vue des nombreuses contradictions sur la toile, les seules qui peuvent encore crier haut et fort les réels problèmes qui sont présents dans leur pays c’est bien les populations, car les habitants voient en direct ce qui se passe, et constatent ensuite la désinformation dans les médias mainstream. Ce qui fait que les journalistes occidentaux sont de plus en plus mal reçus dans les pays d’Afrique, car leur rôle néfaste est mis au grand jour. Le destin des pays d’Afrique est entre les mains de l’union entre les populations, les gouvernements et les armées nationales et non des néocolonialistes !